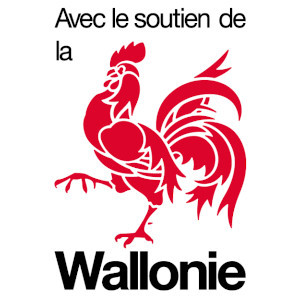Céréales

Le temps sec et ensoleillé se poursuit.
Là où les terres étaient brunes et détrempées l'an dernier, elles prennent aujourd'hui des teintes grises ou beiges. Avec un ciel plus bleu que gris, c'est toute la campagne qui prend ses quartiers d'été bien avant l'heure . La poussière s'envole désormais au passage des tracteurs dont les traces ne laissent plus de vilaines ornières. Difficile de faire plus opposés que février-mars 2024 et février-mars 2025 : plus de 200 L/m² l'an dernier et à peine 40 L/m² cette année. On ne s'en plaindra pas mais on aimerait quand même passer commande pour un peu d'eau qui permettrait aux semis de lever et à l'engrais de trouver les racines.
Les épeautres d'octobre achèvent de taller. Pour les plus précoces d'entre eux, les talles se redressent et l'épi quitte lentement le plateau de tallage. Lorsque l'écart sera d'un centimètre entre l'extrémité de l'épi et le plateau de tallage, le stade BBCH 30 (épi 1 cm) sera atteint. Cela se produira dans les prochains jours. Le nombre de talles est actuellement maximum. Pour les dénombrer, comme chaque épillet semé est à l'origine de deux ou trois plantes entremêlées et difficile à isoler, on compte indistinctement le nombre de talles issues de toutes les graines d'un épillet. Pour les semis précoces, on retrouve facilement entre 15 et 25 talles dont 5 à 10 de belle taille et les autres de taille plus réduite. Pour ces derniers, l'avenir est encore incertain. Ils ne monteront en épi que s'ils disposent de suffisamment de lumière et de nutriments. Si la compétition est trop forte, que ce soit par manque de ressources (faible fertilisation, peu de lumière) ou par excès de compétition (semis trop dense), les plantes supprimeront ces talles devenues excédentaires. On appelle ce phénomène la régression de talles. Il est bien moins connu et étudié que la capacité de tallage et pourtant des observations réalisées l'an dernier montrent que cette régression en épeautre peut atteindre 80% des talles pour une plante et 60 % pour un champ.
Deuxième fraction azotée et premier raccourcisseur.
S'il est moins connu, l'effet de la régression influence profondément la gestion de l'azote. Pour maximiser le rendement, on souhaite une densité d'épis comprise entre 550 et 700 épis/m². En épeautre, contrairement à certains froments et au blé dur, il n'est pas difficile d'atteindre le nombre optimal de talles car l'espèce talle particulièrement bien. Le défi est donc bien plus de conserver ce nombre. Par ailleurs, produire trop de talles au départ peut s'avérer pénalisant pour la plante car c'est de l'énergie perdue qui ne va pas fortifier les talles primaires. C'est entre autres pour cette raison que les premières fractions trop précoces ne sont donc pas recommandées. Par la suite, la deuxième fraction doit permettre au nombre optimal de talles de croître et de se développer.
Actuellement, les épeautres précoces qui ont reçu une première fraction début mars, commencent à montrer les premiers signes de carence. Cette faim d'azote se remarque dans les terres lorsque les zones de redoublage, à l'entrée des fourrières, paraissent plus vertes que le reste de la terre. Il faudrait donc appliquer la deuxième fraction pour limiter la régression des talles. Mais sous quelle forme ? Comme souvent, nous nous trouvons face à un dilemme. Le temps sec prévu pour les 10 prochains jours ne permettra pas aux pellets de N27 de se dissoudre et l'effet sera retardé (peut-être de plusieurs semaines). L'azote liquide et le sulfazote agiront plus vite mais les pertes par volatilisation de l'ammoniaque seront bien plus conséquentes. Cette saison, la solution idéale serait d'injecter l'azote sous forme liquide dans le sol (Photo 2). Des machines le permettent grâce à des roues en inox crantées parcourues de pointes d'injection. On ne trouve pas de tels équipements en Belgique, du moins pas encore, mais ces méthodes sont déjà utilisées dans les sols de Champagne et d'Alsace où les phénomènes de volatilisation sont plus fréquents. Mais soyons pragmatiques, en l'absence de tels équipements, la « moins mauvaise solution » est d'apporter aux épeautres qui le nécessitent (ceux qui montrent des symptômes de carence et/ou qui ne disposent pas d'un grand nombre de talles), l'azote de la deuxième fraction sous forme de sulfazote. Cette formulation semble plus stable que l'azote 39%. Pour les épeautres plus tardifs ainsi que dans les cas de schéma de fertilisation en deux passages (la première ayant été apportée entre le 15 et le 25 mars), le deuxième apport peut avantageusement être reporté.

Concernant l'application d'un régulateur, même si les épeautres les plus précoces sont proches des premiers stades au cours desquels les produits sont agréés (BBCH 29 ou 30), le conseil est de ne pas se précipiter. Il est important que la plante soit en pleine croissance, il est donc préférable d'apporter le régulateur après que la plante ait reçu la deuxième fraction plutôt qu'avant.
Le coin « Culture »
Cette saison, pour ceux qui souhaitent en lire davantage, je propose d'ajouter aux Avis épeautre quelques informations diverses et variées sur l'origine de l'épeautre, son histoire et sa culture dans d'autres pays d'Europe. Ces informations sont principalement tirées de présentations exposées lors d'un Colloque scientifique ayant regroupé à Gembloux des scientifiques français, belges et suisses travaillant sur les céréales, il y a de cela quinze jours.
Le premier « coin culture » concerne l'origine de l'épeautre. Depuis plus d'un siècle, des scientifiques se sont affrontés sur ce thème. Certains prétendaient que l'épeautre était l'ancêtre du blé, d'autres, son descendant provenant de Mésopotamie ou trouvant son origine en Europe. L'avènement des techniques moléculaires a peu à peu permis d'y voir plus clair. Par l'analyse de l'ADN de nombreuses céréales dont des races locales d'épeautre, il est désormais possible d'affirmer que l'épeautre européen diffère de celui d'Asie et qu'il est le fruit d'une hybridation naturelle. Notre épeautre serait issu d'un croisement ayant eu lieu dans les champs des premiers peuples d'agriculteurs vivant au nord des Alpes entre la Bavière (Allemagne) et la Bohème (Tchéquie). Cela se passe il y a 5500 ans à l'époque du Néolithique. Les peuples qui cultivent ces terres sont des descendants des premiers agriculteurs qui ont progressivement migré depuis le plateau d'Anatolie (la Turquie actuelle). Génération après génération, ils ont colonisé toute l'Europe, emportant avec eux leurs céréales. Parmi celles-ci, on identifie clairement l'amidonnier (ancêtre du blé dur) et des blés primitifs (ancêtres de nos froments). L'engrain, appelé petit épeautre était également cultivé avant que son aire de répartition ne se réduise au sud de l'Europe. Génétiquement, l'ADN (=son génome) des amidonniers est constitué de deux génomes apparentés, chacun constitué d'une paire de 7 chromosomes. Un des génomes provient d'un cousin de l'engrain, il est appelé Triticum urartu ; son génome est noté AA. L'autre génome, dénommé BB est, quant à lui, celui d'une mauvaise herbe de l'époque, de la famille des graminées, proche de l'espèce que l'on appelle aujourd'hui Aegilops speltoïdes. L'ADN de l'amidonnier est donc contenu dans 2 x (2 x 7) soit 28 chromosomes. On le dit tétraploïde (tétra = 4). L'amidonnier est panifiable, c'est une céréale à grain vêtu qui ne supporte pas les grands froids. Elle était donc semée au printemps. Les blés primitifs, comme les froments actuels et les épeautres sont eux, hexaploïdes (hexa=6). Ces blés sont issus d'un croisement naturel qui s'est produit il y a 10.000 ans en Mésopotamie (Irak actuel) entre un amidonnier et une seconde espèce d'Aegilops. Cette fois, il s'agissait de Aegilops tauschi. Cette dernière a également apporté une nouvelle copie de 2 x 7 chromosomes portant le génome du blé (AABBDD) à 42 chromosomes. Ce type de croisements interspécifiques ne sont pas rares dans le monde végétal. Dans les cours de biologie que l'on nous a enseignés, la notion d'espèce se définissait comme l'ensemble des individus capables de se reproduire entre eux et de donner une descendance fertile. On sait aujourd'hui, que cette barrière entre espèces est bien plus poreuse que l'on ne l'imaginait. La paléogénétique ne vient- elle pas de nous apprendre qu'en moyenne 2% de notre génome humain provient de l'Homo neanderthalensis (l'homme de Spy), une espèce cousine de la nôtre (Homo sapiens). Pour revenir à notre épeautre, l'analyse de l'ADN en 2024 l'a prouvé, il est le résultat du croisement ou de l'hybridation (c'est un synonyme) d'un amidonnier et d'un blé hexaploïde primitif.

C'est en comparant les différents génomes AA, BB, DD que les scientifiques sont parvenus à cette conclusion. Les génomes AA et BB de l'épeautre sont plus proches (plus similaires) des génomes AABB de l'amidonnier que de ceux de toutes autres céréales. Quant au génome DD de l'épeautre, il est bien plus proche de celui du blé primitif que de celui des Aegilops. Une petite partie de l'ADN des plantes ne se trouve pas dans leur noyau mais dans des organites que l'on appelle des chloroplastes (qui contiennent la chlorophylle). Cette partie du patrimoine génétique ne se transmet que de mère à fille. L'ADN chloroplastique de l'épeautre montre de grandes similarités avec celui d'un ancien amidonnier cultivé en Bohème. Ce qui nous donne à la fois le sens du croisement (l'amidonnier était la femelle, le blé, le mâle) et la région où celui-ci s'est produit (le nord des Alpes). Lorsque l'on reproduit ce croisement et nous l'avons fait à Gembloux, l'on obtient une énorme diversité de descendants dont certains présentent tous les caractères des épeautres. Par rapport à ses parents, l'épeautre était bien mieux adapté à l'Europe. Il était bien plus résistant au froid, aux excès d'eau ou à la germination sur pied. Ses balles le protégeaient des oiseaux, de certaines maladies et de nombreux insectes des denrées. Nos ancêtres s'en sont rendus compte. Ils l'ont adopté et favorisé lors de leurs semis. Quelques millénaires plus tard, ces peuples sont devenus les Gaulois, agriculteurs hors-pairs à l'origine de très nombreuses innovations et l'épeautre était leur blé. Le blé des Gaulois…
Je vous souhaite une très agréable semaine ensoleillée,
Guillaume Jacquemin