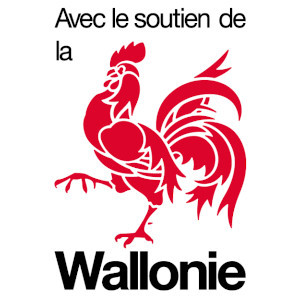Céréales

(Gembloux, 7 avril)
De la pluie bientôt ?
Lecteurs et auditeurs attentifs des bulletins météo, vous en avez tous entendu parler : le vortex polaire s'est arrêté de tourner. On parle d'une désagrégation précoce. Nombre d'entre nous ne connaissaient pas ce terme ; pourtant ce mécanisme est un des principaux responsables de notre climat tempérée océanique. L'IRM nous apprend que ce vortex polaire est un énorme courant d'air glacial qui tourne en permanence au-dessus des pôles. On peut l'imaginer comme une grande bulle d'air froid enfermée par des vents très puissants. En temps normal, ces vents continuent de tourner jusqu'à la fin du printemps mais cette année sous l'influence d'un réchauffement précoce de la stratosphère (12 à 50 km d'altitude), le vortex s'est déformé et de l'air froid s'en est échappé. Le vortex a alors perdu de sa force et n'entraîne désormais plus les masses d'air à tournoyer d'ouest en est. Celles qui arrivent sur la Belgique ne proviennent plus de l'Atlantique et ne se sont pas chargées en eau. Leur axe de déplacement est désormais un axe Nord-Sud et notre climat cesse pour un temps, d'être « océanique ». Après, selon que le vent provienne du Nord ou du Sud, nous profitons ou subissons les températures véhiculées par ces masses d'air. Comme, vous l'avez sans doute remarqué, ces dernières semaines, les girouettes pivotent chaque weekend. Donc après une semaine de fraicheur, on devrait retrouver de l'air chaud la semaine prochaine.
Pour la pluie, la situation est plus incertaine, on annonce son retour à partir de dimanche mais tant que la circulation des masses d'air ne reprendra pas un axe Ouest-Est, les quantités d'eau resteront faibles.
Les sols devraient donc continuer à sécher voire à s'assécher. Si c'est le cas, ils ne seront plus à même de jouer un rôle tampon lors des journées de fortes températures ce qui nous prédispose à un été chaud voire très chaud, autant le savoir. En fait pour une fois, nous n'avons pas l'impression de vivre une situation inédite : nous sommes pour l'instant dans les traces de ce que nous avons connu en 2022. L'année ne fut pas mauvaise, espérons que 2025 le soit également.
Stade de développement
La très grande majorité des épeautres d'octobre ont maintenant atteint le stade épi 1cm (BBCH30), l'épi poursuit sa course entraînant derrière lui, les nœuds qui apparaissent distinctement lors de la dissection. Le premier de ceux-ci est désormais bien séparé du plateau de tallage (1-3 cm) mais le second ne lui étant pas encore distant d'au moins 1 cm, le stade premier nœud (BBCH 31) n'est pas atteint. Le nombre de talles est encore en augmentation par rapport à la semaine dernière. Il se situe entre 15 et 25 pour les plantes isolées. La régression dont nous parlions la semaine dernière n'a pas encore débuté.
Plan anti-sécheresse
Pour les parcelles semées tardivement dont les plantes n'ont pas encore atteint le stade BBCH 30 et pour lesquelles les épis sont encore bien protégés à proximité du plateau de tallage, il est encore temps de rouler la terre avec un rouleau (type Cambridge). Cela aura pour effet de perturber les flux de capillarité et ainsi de conserver plus d'eau dans le sol. Un autre effet positif dans les situations où le couvert des plantes n'est pas encore optimal, sera de renforcer les plantes et le tallage. C'est parfois nécessaire pour les semis tardifs qui ont subi quelques dégâts suite aux précipitations hivernales.
Fertilisation
Il est désormais temps d'apporter la deuxième fraction azotée lorsqu'un total de trois sont prévues. Actuellement, les températures sont trop froides pour le faire sous forme liquide sans risque de brûler les feuilles. Cette semaine, seule l'option de la forme solide est conseillée. Les légères pluies annoncées pour la semaine prochaine devraient permettre de dissoudre le N27. Une autre option est d'attendre quelques jours que les températures remontent pour appliquer de l'azote liquide ou du sulfazote. Généralement pour l'épeautre, nous conseillons de ne pas dépasser 100 unités d'azote sur la somme des deux premières fractions. Cependant cette année, au vu des pertes engendrées par la météo et le risque moindre de verse, je pense que la limite peut être augmentée d'une dizaine d'unités.
Régulateur de croissance
L'épeautre est plus sensible à la verse que la majorité des céréales. Pour rappel, bien que la verse survienne généralement lors des orages de juin et de juillet, la sensibilité de la culture est principalement définie lorsque les premiers entre-nœuds des tiges s'allongent c'est-à-dire durant les prochaines semaines. Cet allongement lorsqu'il est trop rapide, se produit au détriment de l'épaisseur de la tige et de sa solidité. D'une manière générale, tout ce qui accélère l'élongation augmente le risque de verse, tout ce qui la ralentit renforce la culture.
Les densités de semis et les fertilisations, lorsqu'elles sont excessives, sont responsables de nombreux accidents de verse. Le temps couvert et les températures poussantes provoquent l'étiolement, alors qu'un temps lumineux et frais permet aux tiges de se renforcer. On le sait moins, mais le vent lors de la montaison peut aussi contribuer à la solidité des tiges. Ce printemps 2025 tous les éléments météorologiques sont réunis pour que le risque de verse soit limité.
On ne le sait pas assez mais nous payons deux fois l'application des traitements régulateurs. La première fois à l'achat, la seconde à la récolte de par le nombre de quintaux perdus. Ces produits bien qu'utiles certaines années, ne sont pas innocents et ils sont à utiliser avec réflexion. Sur les 3 dernières années, François Henriet et son équipe ont réalisé des essais comparatifs des différents régulateurs en épeautre (voir Livre Blanc Céréales). Sur les 3 ans, 2023 était une année à verse et cela se savait dès le mois d'avril. Cette année-là, le conseil stipulait de ne pas hésiter et d'employer deux traitements. En 2024, un traitement a été conseillé au stade BBCH 30-31 mais pas le second car du 15 au 27 avril il a fait froid et que cela a tenu lieu de raccourcisseur. Aucune verse n'a été à déplorer. En 2022, les conditions étaient très similaires à celles d'aujourd'hui, là non plus il n'y a pas eu de verse mais l'incidences des différents produits quant à leur phytotoxicité a pu être notées. Sans surprise, tous les produits à base de trinexapac-éthyl se sont avérés bien plus agressifs que les autres. Les pertes de rendements pour l'utilisation de ces produits pouvaient s'élever à 9 quintaux/ha.
J'aimerais pouvoir vous conseiller une variété d'épeautre inversable mais ce n'est pas encore le cas et en attendant, se passer totalement de régulateur lorsque la fertilisation se situe entre 120 et 170 unités d'azote reste un risque. C'est pourquoi, cette saison, nous appliquerons sur nos essais traités, un traitement régulateur mais il sera unique et n'utilisera pas de Trinexapac-ethyl. Nous lui préfèrerons des alternatives contenant du Chlormequat chlorure (Cycocel®) ou de la Prohexadione-Ca (Ex : Fabulis®) accompagné ou pas de Chlorure de Mepiquat (Ex : Medax Top®).
Une des raisons de ce traitement, bien que nous ne craignions pas la verse, est l'effet positif de ces traitements sur les bris de tiges et bris d'épis qui peuvent constituer un véritable problème en épeautre. Des essais sont en place pour acquérir un recul suffisant sur cette problématique.
Le coin « Culture »
A la suite de cet avis agronomique, pour ceux qui souhaitent en lire davantage, je vous propose cette fois, une réflexion archéologique sur la méthode de récolte de l'épeautre par les Celtes. La semaine dernière, l'avis se clôturait sur la période gauloise et leurs techniques agricoles. Outre, l'invention du tonneau, du soc de l'araire, de la herse ferrée, de la faux ou de la roue cerclée de fer, on doit également aux Celtes, l'invention de la première « moissonneuse ». Ces engins agricoles appelés « Vallus » ont été essentiellement retrouvées sur le territoire de la Gaule Belgique (qui s'étendait jusque Trèves à l'est et jusque Reims au sud). Il s'agit d'un char à deux roues muni d'un bac récolteur qui portait, sur le bord avant, un rang de lames dentelées à la façon d'un peigne (photo 2). Le char était poussé par des bœufs ou des ânes.

Evidemment, il s'agit plus d'une récolteuse d'épis que d'une moissonneuse au sens actuel du terme car elle ne coupe en rien les chaumes. A l'avant pas de lames, pas de dents coupantes juste un long peigne immobile. A première vue, on a du mal à imaginer comment en déplaçant une « brouette » dans un champ, on puisse en ressortir avec un bac rempli d'épis. Les archéologues se sont d'abord cassé les dents sur cette question et la reconstitution d'un vallus n'a pas, dans un premier temps, apporté de réponse satisfaisante. La machine écrasait les cultures et n'apportait pas grand-chose de plus qu'un simple bac mobile dans lequel les agriculteurs déposaient les épis coupés à l'aide de leur serpe ou de leur faux. Pour comprendre toute l'ingéniosité de nos Gaulois, il fallait se rappeler que ces derniers ne cultivaient pas de froment mais de l'épeautre. De plus, les races d'épeautre anciennes ont toutes comme caractéristiques d'avoir des rachis et des cols d'épis (dernier entre-nœud sous l'épi) cassant à maturité. En intervenant, au bon moment, dans leur champ d'épeautre, les agriculteurs gaulois pouvaient ainsi récolter de manière rapide et efficace.

En ne semant que des épillets récoltés à l'aide d'un vallus, les agriculteurs gaulois pratiquaient déjà une forme de sélection favorisant les épis cassants. L'utilisation du vallus s'est transmise jusqu'au début du moyen-âge. Dès lors, pendant plus de 1000 ans, les épeautres ont été sélectionnés dans ce sens. Pas étonnant donc que ce caractère cassant des cols et des rachis soit encore présent chez certaines variétés modernes (voir photo 4).

Après avoir été longtemps une qualité, c'est devenu un défaut. La sélection actuelle travaille à contre-courant de ce qui a été fait par le passé. De nombreuses variétés modernes sont désormais plus résistantes à ces bris. Pour les variétés disposant encore de ce caractère ancestral (Zollernfit, Lucky, Convoitise,…), un seul conseil, ne pas attendre la sur-maturité et récolter ces variétés en priorité lors des années difficiles comme le fut 2023.
Je vous souhaite une agréable semaine fraichement ensoleillée,
Guillaume Jacquemin